La nécrose ou pourriture apicale de la tomate
La nécrose apicale, ou pourriture apicale, communément appelée le « cul noir de la tomate », est un trouble physiologique qui affecte les tomates de nombreux jardiniers. Cette altération se caractérise par l’apparition de taches noires, déprimées et sèches à l’extrémité apicale du fruit en développement. Bien que des recherches aient été menées pour comprendre ses causes, la nécrose apicale demeure un problème complexe lié à des facteurs multiples, tels que des déséquilibres nutritionnels, des variations environnementales et des problèmes d’irrigation. Dans cet article, nous verrons quelles sont les causes de ce trouble et proposerons des stratégies pour minimiser son impact et améliorer la production de tomates de manière durable.
Les causes et hypothèses
Calcium et stress hydrique

Tout d’abord, la nécrose apicale est un trouble physiologique, tout comme le collet jaune de la tomate, due à une mauvaise assimilation du calcium par la plante. Le calcium est mal absorbé et ne parvient pas jusqu’à l’extrémité des fruits.
L’hypothèse la plus courante est que ce manque de calcium est lié à un stress hydrique, par manque d’eau. Il est rare qu’un sol manque de calcium. Si le calcium est mal acheminé jusqu’à à l’extrémité des fruits c’est probablement du à une circulation insuffisante de sève élaborée, dont le principal constituant est l’eau.
Bien que ce ne soit pas l’objet de l’étude suivante on peut voir que l’apport en eau à une influence sur la pourriture apicale :
Pour voir l’étude en entier suivez le lien : Optimisation de l’irrigation en culture biologique de tomate sous abri. (Mise à jour 2018 : la publication a été supprimée du site « ardepi.fr »).
Cette étude agronomique menée par le Grab (Groupe de recherche en agriculture biologique) montre que dans le cas d’une irrigation restreinte (30% d’eau en moins) le nombre moyen de tomates (sur une moyenne de 18 variétés) étant atteintes de nécrose apicale est de 2 par m² contre 0,1 par m² dans le cas d’une irrigation normale.
Soit 20 fois plus de fruits atteints de nécrose apicale dans le cas de l’irrigation restreinte.
On voit par cette étude que le facteur d’irrigation a une influence sur le nombre de tomates atteintes de nécrose apicale.
Dans cette étude les plantes en irrigation restreinte étaient tout de même arrosées régulièrement. Dans votre potager il est fort possible que le nombre de fruits atteints soit bien supérieur, surtout si les plantes ont souffert sur une longue période d’un manque d’eau.
Autres causes possibles
Source : Ce document d’André Carrier sur Agrireseau
- Manque de phosphore
- Blocage de l’absorption de calcium par antagonisme avec le potassium, le magnésium et l’azote ammoniacal. Ce dernier peut être favoriser lors d’une fertilisation chimique.
- Sol pas assez réchauffé
- Salinité trop élevée
- Racines en mauvais état. Binage trop profond, agent pathogène, etc.
Un effet également variétal
Vous observerez que certaines variétés sont plus prédisposées à avoir cette maladie. Ce qui va être le cas dans un jardin ne va pas forcément être le cas dans un autre. On dit que les variétés longues, les charnues sont plus sensibles à cette maladie; en réalité les autres formes sont aussi touchées. N’hésitez pas à partager votre retour d’expérience dans un commentaire ci-dessous.
Que faire contre la nécrose apicale de la tomate ?
En préventif
- A la mise en place de la culture, apportez suffisamment de compost à votre plate bande et une bonne quantité dans chaque trou de plantation. Ayez l’image d’une éponge, le compost absorbe l’eau et retient l’eau puis il la restitue lorsque le milieu s’assèche
- Toujours à la mise en place, apportez un peu de cendre de bois (attention au pH du sol), riche en potasse et en calcium.
- Arrosez régulièrement et suffisamment (sans aller jusqu’à l’excès).
- L’emploi d’un tuyau micro-poreux est une bonne solution, vérifiez aussi l’arrosage en carottant.
- Paillez afin de maintenir l’humidité et la vie du sol (on favorise ainsi les mycorhizes, les micro-organismes en général et par conséquent la biodisponibilité des éléments, dont le calcium).
Corriger le tir en cours de culture
Si vos tomates sont déjà atteintes de nécrose apicale :
- Retirez les fruits nécrosés. Vous pouvez éventuellement garder les moins atteints pour les laisser venir à maturité. Pas de problème pour les mettre au compost
- Arrosez régulièrement et paillez si ce n’est pas déjà fait.
- Même si l’arrosage est ré-équilibré apportez du calcium pour endiguer la pourriture (lait dilué, carbonate de calcium, sable calcaire)
- Quelques jours après avoir corrigé le stress hydrique, les stomates de la plante vont se ré-ouvrir, pulvérisez alors un extrait fermenté de consoude à 5% (contient du calcium) le matin. L’absorption du calcium se fera en foliaire en complément du racinaire. De plus la potasse et le bore vont favoriser la fructification et la nouaison pour des nouveaux fruits sains.
- Renouvelez ce traitement deux semaines plus tard.
En conclusion sur la nécrose apicale de la tomate
Nous avons donc vu que cette maladie n’était pas due à un pathogène et qu’une bonne prévention résidait dans un arrosage régulier et suffisant. Il est fort possible que l’origine de la nécrose soit autre, auquel cas il faudra vous pencher sur les autres causes citées dans l’article.
N’hésitez pas à partager votre expérience sur le sujet en laissant un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu ce problème ? Avez-vous réussi à le corriger, voir à le supprimer pour de bon au fil des années ? Comment y-êtes vous parvenu ? Qu’elles sont vos variétés les plus sensibles ? Et les plus résistantes ?
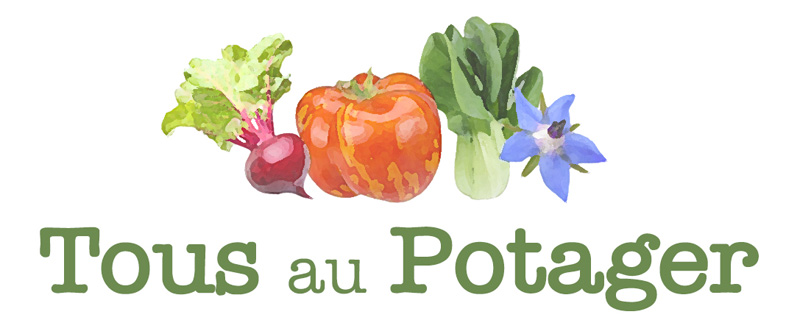

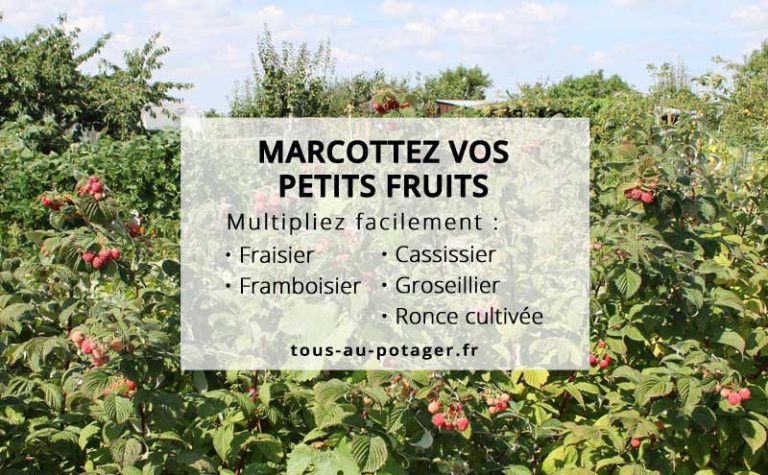




Bonjour Aurélien, merci pour votre blog intéressant. j’ai commencé l’an dernier la plantation de tomates en pots à l’abri grâce à un avant toit (en pleine terre l’an précédent mildiou suite à 3 sem consécutives de pluie). Presque toutes mes variétés anciennes (sauf celles dont j’avais fait les semis) ont eu la pourriture apicale. Misère:-( j’avais pourtant bien arrosé. ma questions : Est-ce que la cendre est à mettre dans le trou de plantation et pourriez-vous me dire combien signifie « un peu ». A vous lire. cordialement. Griselda
Bonjour Griselda,
Merci pour votre message
Oui « un peu » n’est vraiment pas précis… ;-)
Vous pouvez mettre l’équivalent d’une bonne poignée par trou de plantation. Mélangez la cendre avec le compost (1 à 2 pelletés par trou).
Les orties peuvent être fraîches comme sèches. De toute façon elles vont sécher et vous pouvez en rajouter régulièrement (ou remplacer avec de la consoude)
N’hésitez pas à me tenir au courant
Aurélien
Oups, autre question concernant le paillage ortie, les orties doivent être fraîches au moment ou on les met ou doit les sécher avant ?
Cordialement. Griselda
bonjour Aurélien, vos idées sont lumineuses et très utiles pour « cultiver son jardin »; sauf que pour les grandes surfaces, il y a des techniques presque similaires pour l’enfouissement des engrais verts (les herbes naturellement) ainsi au moment du printemps où il y a déjà floraison pour avoir un bon volume, procéder au fauchage, laisser faner une petite semaine et labourer. vous obtenez des engrais à grande échelle + des « réserves utiles » d’eau pour vos cultures semées en automne suivant. nous appelons cette méthode ‘labours de printemps’ ou ‘dry-farming’ très valable chez moi (Algérie) en zone semi-aride. Je souligne l’importance de la matière organique (fumier bien décomposé, compost, etc..) pour l’augmentation des défenses immunitaires des cultures, des rendements, de la qualité des produits, de leur goût et arômes. Bien azzul (salut) à toi
Merci Aurélien pour vos conseils.
Grace à la consoude, je suis venue à bout de la nécrose apicale sur mes tomates « Rose de Berne » et « Cornue des Andes »
Pour la première année de culture sur buttes (permaculture), mes tomates les « Rose de Berne » et les « Cornue des Andes » avaient le meilleure rendement, en ce 23 septembre plus de 5kgs. par pied, sur 12 variétés plantées.(peut-être effet consoude?)
Cordialement Michel
Bonjour Michel,
Merci pour votre retour et super pour vos tomates !
Vous avez pulvérisé de l’extrait fermenté de consoude à quelle fréquence ?
Un bon paillis et une bonne gestion de l’arrosage contribuent aussi à régler ce problème. J’imagine que vos buttes sont paillées.
Aurélien
Bonjour Aurelien,
Dés le début de la nécrose apicale, sur mes « Rose de Berne » et « Cornue des Andes » le 26 juin,j’ai pulvérisé une 1ère.x une décoction de consoude et 9 jours après de la consoude fermentée (purin).
La culture sur butte ne demande pas d’arrosage pour les tomates, ni pour les courges, mais un apport de purin, un litre par pied tous les 9 jours,
– ortie au dés la plantation,
– mélange ortie-fougère par la suite,
– consoude à partir de fin juillet.
Comme couverture sur mes buttes à tomates j’utilise du broyat.
Michel
Bonjour!
merci pour les infos. Je cultive entre 5 et 10 variétés de tomates. Cette année j’avais la pourriture apicale uniquement sur les cornes des Andes. Donc chez moi c’est semble-t-il directement lié à la variété. Black Plum, Crimée, Carotina, Rouge de Chancy, Jaune du Lac de Bret – pas de soucis.
Bonjour,
C’est vrais que les ‘Cornues des Andes’ ‘Rose de Berne’ ‘Roma’ sont les tomates les plus sensible à la pouriture apicale.
Ma tomate préférée est la ‘CARO RICH’ une tomate sans problèmes et très riche.
Bonjour,
Petite précision,la nécrose apicale est une carence physiologique non une maladie !
Comment expliquer que dans l’Héraut Pascal Poot ne rencontre pas ce problème
dans la culture de ses tomates, sans aucun arrosage si ce n’est à la plantation !
Bonjour,
Par définition une maladie est une altération de l’état de santé, quelque soit l’origine. J’ai précisé « maladie physiologique » du en effet à une carence.
En fait, peut-être que pour vous, une maladie est forcément due à un facteur biotique, d’origine parasitaire, mais ce n’est pas forcément vrai, elle peut être aussi du à un facteur abiotique, c’est à dire non parasitaire (comme ici). Je garde donc les termes « maladie physiologique » pour définir la nécrose apicale.
Généralement les jardiniers qui rencontrent ce problème, ne cultivent pas comme Pascal Poot qui privilégie un jardin vivant (ce que j’encourage aussi).
Ses semences s’adaptent à son terroir et à sa façon de cultiver. Le fait de ne pas habituer les plants à recevoir de l’eau dès le départ (sauf à la plantation) va forcer les racines a aller chercher cette eau en profondeur.
De plus, son sol étant vivant, il se forme très probablement des mycorhizes entre champignons et tomates. Cette association symbiotique permet d’apporter de l’eau et des nutriments à la tomate qui offre en échange des « sucres » au champignon.
Il y a surement d’autres raisons, son sol est à dominance argileuse je crois, il retient un peu mieux l’eau. Etc…
Voilà, je le redis si ce n’est pas clair dans l’article, chercher à avoir un sol vivant permettra d’écarter ce problème. Je pense que c’est la solution long terme et celle qui faut privilégier.
J’ai présenté dans cet article d’autres solutions « court terme » dont l’arrosage plus régulier.
Aurélien
ou trouver extrait fermenté de consoude à 5%
Malgré tous vos conseils,je suis toujours confronté à cette nécrose apicale
Certaines variétés sont plus sensibles : Roma, andine cornue,rose de Berne
Cette année c’est la Roma qui est affectée.
J’ai l’impression qu’il n’il n’y pas de véritable solution
A propos de Poot… encore faut-il que ce que l’on voit sur ses vidéos corresponde mieux à la réalité que ce que le résultat que j’ai obtenu avec les graines que je lui ai achetées : peu de levée et production lamentable de ce qui a bien voulu donner des plants viables. Pour ne pas parler du fait que, interrogé à ce sujet, il n’a même pas répondu à mon mail.
Alors Poot = vrai pro du jardinage ou du web-marketing ?
merci de partager votre savoir faire. bonne journée , que Dieu vous garde.
Bonsoir, je suis producteur de légumes et j’ai subi lors de ma première production la nécrose apicale sur une superficie d’environ 1,5 ha de tomate de variété SAVERA. Mon système d’arrosage est constitué de goutte-à-goutte. Pour mon cas, sans être à 100% affirmatif je peux dire que l’arrosage n’a pas été défaillante car les plants étaient régulièrement et suffisamment arrosés. Par contre je soupçonne un apport trop important de fumier chimique ayant certainement occasionné un conflit avec les autres constituants en apport dans le sol, ce qui a fait un bloquage chez certains composants. Nous avons tenter vainement de corriger le défaut en faisant traitement partiels et isolés constitués en apportant des compléments d’azote et autres éléments bloqués dans le processus. Nous avons ainsi perdu toute la production soit environ 30 tonnes de tomates. Nous avons lancé notre deuxième production avec une autre variété de tomate et avec plus de précaution dans le rythme d’arrosage et le plan de fertilisation….espérant que cette fois ci sera la meilleure
Bonjour Fredéric,
Je suis étonné que vous ayez tenté de corriger la nécrose en apportant de l’azote. Vous devriez éventuellement faire un test pour analyser la composition de votre terre. Avec le LAMS par exemple.
3.5
4.5
5